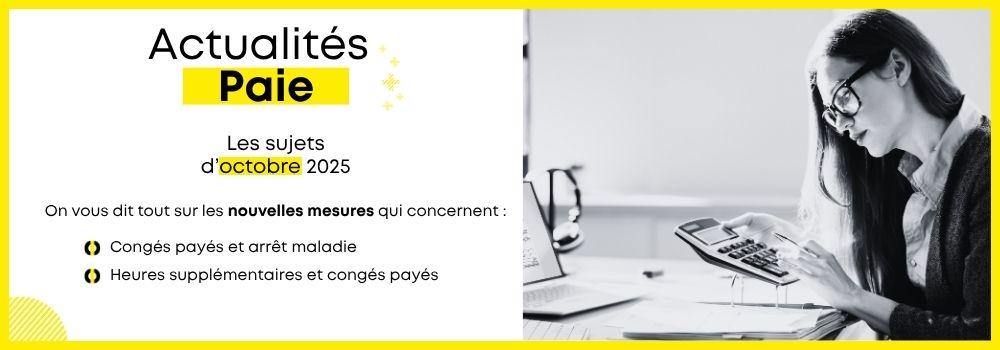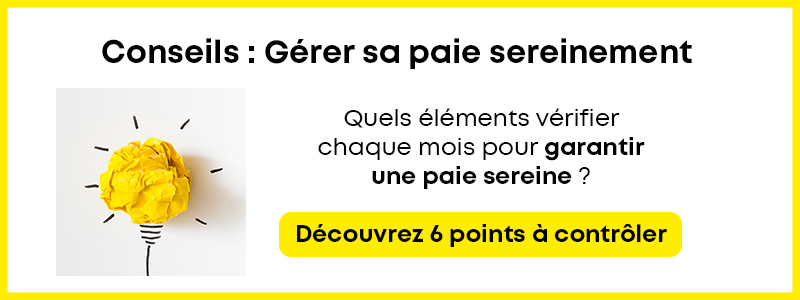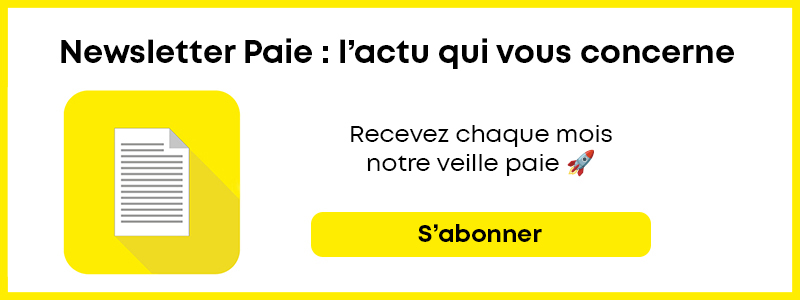Ce mois-ci, dans les actualités Paie, on parle report des congés payés coïncidant avec un arrêt maladie et les conséquences pratiques en paie. Au programme également, les congés payés désormais pris en compte dans le décompte des heures supplémentaires avec un exemple concret d’application de la nouvelle jurisprudence pour éviter les erreurs de calcul.
Report des congés payés coïncidant avec un arrêt maladie
Par une décision en date du 10 septembre 2025, la Cour de cassation a eu à se prononcer sur une question qui a déjà fait couler beaucoup d’encre, à savoir : un salarié placé en arrêt maladie pendant une période de congés payés (CP) a-t-il droit au report des jours de repos coïncidant avec l’arrêt de travail ?
Le Code du travail n’apportant, à ce jour, aucun élément de réponse, c’était l’occasion pour la Cour de cassation de mettre à jour sa jurisprudence et de bâtir la marche à suivre pour les employeurs.
Jusqu’à présent, et de jurisprudence ancienne, la Cour de cassation considérait qu’un salarié qui tombait malade pendant ses congés payés ne pouvait exiger de prendre ultérieurement le congé dont il n’avait pu bénéficier du fait de son arrêt de travail.
Au fil du temps, la position de la Cour de cassation s’est fragilisée, allant même jusqu’à être opposée à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE) qui considère, depuis 2012, que le salarié peut bénéficier du report lorsque l’arrêt maladie coïncide avec la période de congés payés.
La CJUE a pris la peine d’expliquer son arrêt par le fait que la finalité du droit au congé annuel est de permettre au salarié de se reposer et de disposer d’une période de détente et de loisirs, ce qui diffère du droit au congé de maladie accordé au salarié pour qu’il puisse se rétablir.
Bien que, comme l’admet la Cour de cassation, « le défaut de conformité du droit interne n’était guère discuté », aucun litige ne lui avait donné l’occasion de remettre en cause sa jurisprudence de 1996.
Un arrêt de mise en conformité au droit européen
C’est donc par un arrêt daté du 10 septembre 2025 que la Cour de cassation a saisi l’occasion de mettre sa jurisprudence au diapason de celle de la CJUE en jugeant qu’un salarié placé en arrêt maladie pendant ses congés payés a droit au report des CP coïncidant avec la maladie, à condition d’en avertir l’employeur.
Exemple : Un salarié est en congés payés du 4 octobre 2025 au 19 octobre 2025. Il tombe malade le 6 octobre 2025, date à laquelle il consulte son médecin traitant qui le place en arrêt maladie jusqu’au 16 octobre 2025. Selon la position de Cour de cassation, le salarié pourra bénéficier du report des congés payés dont il n’a pas pu pleinement bénéficier entre le 6 et le 16 octobre 2025.
Des interrogations pratiques en suspens
La Cour de cassation pose néanmoins une condition essentielle à ce droit au report, celle de la notification par le salarié à son employeur de l’arrêt maladie.
Toutefois, la juridiction ne précise pas les modalités de cette notification, ni le délai à respecter pour le salarié.
Reste donc à savoir si, dans un arrêt qu’elle aurait à juger ultérieurement, la Cour de cassation considérerait qu’il s’agit d’un délai :
- De 48h, qui serait d’une durée similaire à celui de l’envoi par le salarié de son arrêt à son employeur pour pouvoir bénéficier du maintien employeur légal ;
- Raisonnable, qu’il conviendra aux juges d’apprécier à chaque nouvelle affaire portée à leur connaissance ;
- Spécialement prévu à cet effet.
De plus, concernant les modalités du report des jours de congés payés, la rétroactivité et la prescription, reste à savoir s’il conviendrait d’appliquer les règles prévues par le Code du travail depuis la loi DDADUE du 22 avril 2024, conformément à ce que préconise le Ministère du travail.
Il n’est pas à exclure que le législateur puisse être amené à se pencher sur l’intégration des solutions à ces interrogations dans le Code du travail, voire dans le Code de la sécurité sociale.
Conséquences pratiques de cette jurisprudence en paie
L’arrêt de travail notifié suspend le contrat de travail même si le salarié est en congé payé. On peut supposer que la période de congés payés est elle-même suspendue pour la durée de l’arrêt maladie.
À l’issue de l’arrêt maladie, soit la durée de congés posée n’est pas expirée et alors le salarié est en congé jusqu’au terme initial, soit elle est expirée et le salarié reprend le travail.
Si l’arrêt maladie a été notifié à la sécurité sociale dans les 48 heures et à l’employeur dans les délais légaux ou conventionnels, se met alors en place l’indemnisation de la période de maladie dont les modalités dépendent des choix de l’employeur, de l’ancienneté du salarié et des dispositions conventionnelles.
L’employeur doit alors régulariser la paie, informer le salarié et appliquer, comme le ministère du travail le préconise, les dispositions du Code du travail relatives au droit au report des congés payés :
- Faire un signalement DSN d’arrêt de travail ;
- Recalculer l’indemnité de congés payés et, en cas de trop-versé, retenir la part d’indemnités correspondant aux jours de congés payés coïncidant avec la période de maladie ;
- Opérer le maintien de salaire, s’il y a lieu, après décompte du délai de carence éventuel ;
- Calculer le nombre de jours de congés payés reportés et informer le salarié, dans le mois suivant sa reprise, du nombre de jours de congés dont il dispose et de la date jusqu’à laquelle ces jours de congés peuvent être pris. En application des règles de report des congés payés issues de la loi du 22 avril 2024, si la période de prise des congés est en cours, l’employeur pourrait imposer la prise des congés reportés sous réserve de respecter le délai de prévenance d’un mois. Si la période est expirée ou ne permet pas de solder l’intégralité du reliquat de congés payés acquis, le salarié bénéficie d’une période de report de 15 mois débutant à réception de l’information ;
- Penser à tenir compte de cet arrêt de travail dans le calcul des congés payés de la période d’acquisition en cours puisqu’il donne droit à congés payés à raison de 2 jours ouvrables par mois au lieu de 2,5, sous réserve de dispositions conventionnelles plus favorables.
Il est utile de rappeler que les IJSS sont versées après un délai de carence de 3 jours et le complément légal à la charge de l’employeur à partir du 8e jour d’arrêt. Il est donc fort probable que certains salariés renonceront à notifier leur arrêt de travail s’il en découle une perte de revenus.
Décompte des heures supplémentaires : les congés payés sont pris en compte
Selon le Code du travail, constitue une heure supplémentaire toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou, pour les professions concernées, de la durée considérée comme équivalente à la durée légale.
Ainsi, pour déterminer le nombre d’heures supplémentaires éventuellement dues, seules sont prises en compte les heures de travail effectif (ou assimilées pour le calcul des heures supplémentaires). Pour la Cour de cassation, il en résultait jusqu’à présent qu’à défaut de dispositions légales, conventionnelles ou d’usage contraires, les jours de congés payés, n’étant pas assimilés à du temps de travail effectif, n’avaient pas à être pris en compte pour la détermination des heures supplémentaires.
Il en va tout autrement du côté du juge européen.
En effet, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a développé toute une jurisprudence visant à garantir la prise par les travailleurs de leurs jours de congés payés en estimant que :
L'obtention de la rémunération ordinaire durant les congés payés vise à permettre au travailleur de prendre effectivement ses jours de congé ;
Toute pratique ou omission d'un employeur ayant un effet potentiellement dissuasif sur la prise des congés payés par un travailleur est incompatible avec la finalité du droit au congé annuel, tenant notamment à la nécessité de garantir au travailleur le bénéfice d'un repos effectif, dans un souci de protection efficace de sa sécurité et de sa santé ;
Un travailleur pouvait être dissuadé d'exercer son droit à congés payés compte tenu d'un désavantage financier, même intervenant de façon différée, à savoir au cours de la période suivant celle du congé annuel.
Enfin, en 2022, la CJUE a affirmé que le droit européen s’opposait aux dispositions d'une convention collective qui, pour déterminer si le seuil des heures travaillées donnant droit à majoration pour heures supplémentaires est atteint, excluent les heures correspondant aux congés payés pris par le travailleur.
Prise en compte des jours de CP pour le décompte des heures supplémentaires
Sous l'influence de la jurisprudence européenne, la position de la Cour de cassation risquait fort d'évoluer. C’est aujourd’hui chose faite puisque la Cour de cassation, par plusieurs arrêts en date du 10 septembre 2025 a eu l’occasion d’écarter partiellement l’application des dispositions légales « en ce qu’elles subordonnent à l'exécution d'un temps de travail effectif les heures prises en compte pour la détermination du seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable à un salarié, soumis à un décompte hebdomadaire de la durée du travail, lorsque celui-ci, pendant la semaine considérée, a été partiellement en situation de congé payé ».
Les juges de cassation ajoutent que le salarié peut prétendre au paiement des majorations pour heures supplémentaires qu'il aurait perçues s'il avait travaillé durant toute la semaine.
Autrement dit, la Cour de cassation considère désormais que, pour les salariés soumis à un décompte hebdomadaire de la durée du travail, les jours de congés payés doivent être pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires.
Il est à souligner que la notice jointe à l’arrêt souligne que « la solution dégagée reste circonscrite au décompte hebdomadaire de la durée du travail qui était appliqué dans l’espèce […] et ne préjuge pas de la solution quant aux autres modes de décompte de la durée du travail, puisque la solution énoncée par la Cour de justice de l’Union européenne repose sur l’effet potentiellement dissuasif du système de détermination des heures supplémentaires applicable en droit interne sur la prise du congé payé par le salarié ».
Reste donc à savoir si les pouvoirs publics s’empareront du sujet pour définir un cadre d’application. Cela permettrait également de savoir si le raisonnement de la Cour de cassation s’applique aux 5 semaines de congés payés prévues par le Code du travail ou aux seules 4 semaines de congés payés garanties par le droit européen, ce que la juridiction omet de préciser dans sa solution.
Exemple d’application de la jurisprudence
Un salarié mensualisé est soumis à une durée collective du travail de 35 h par semaine, répartie à raison de 7 h par jour du lundi au vendredi. Il est en congés payés du lundi 15 au mardi 23 septembre 2025 inclus. Les 24, 25 et 26 septembre 2025, le salarié travaille 8,5 h par jour à la demande de son employeur.
Selon la jurisprudence française antérieure au 10 septembre 2025, il était possible d'ignorer les jours de congés payés pour le décompte des heures supplémentaires. Juridiquement, il n’y avait pas d’heures supplémentaires majorées sur cette semaine (3 × 8,5 < 35 h). Les 4,5 h effectuées en plus les 24, 25 et 26 septembre devaient bien être ajoutées à la paye, mais en étant rémunérées au taux normal, sans majoration de salaire.
Avec la jurisprudence du 10 septembre 2025, sur la semaine du 22 au 28 septembre, il faut tenir compte des heures correspondant aux jours de congés payés pour le décompte des heures supplémentaires : 7 h + 7 h + (3 × 8,5 h) = 39,5 h, soit 4,5 h au-delà de la durée légale. Le bulletin de paie du mois de septembre devra comprendre 4,5 heures supplémentaires payées à la majoration correspondante.
Vous êtes gestionnaire de paie ? Restez serein face aux évolutions légales en adoptant la solution complète 123Paie.