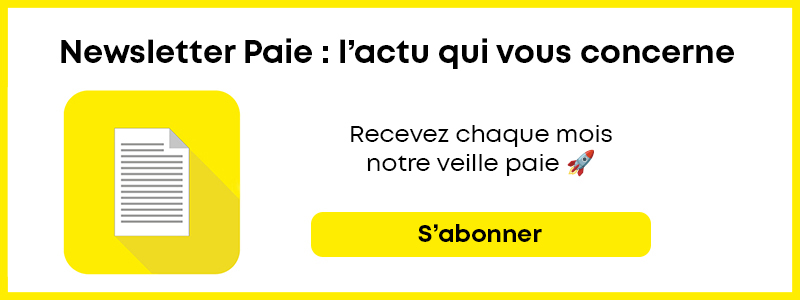La rentrée approche avec son lot de nouveautés. Parmi celles-ci, on fait le point sur les évolutions qui concernent la Loi senior : nouveau type de CDI et traitements en paie. Sans oublier l’individualisation du taux de prélèvement à la source qui devient désormais la norme !
Un nouveau CDI : le contrat de valorisation de l'expérience
A la suite d’une commission mixte paritaire conclusive, le Sénat a voté le projet de loi portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l’emploi des salariés expérimentés et relatif à l’évolution du dialogue social (dite « Loi séniors »).
La loi entrera en vigueur à la rentrée, après adoption définitive par l’Assemblée nationale et publication au Journal officiel.
Nous connaissons d’ores-et-déjà les détails du nouveau contrat de travail qu’elle instaure.
Mise en place du contrat de valorisation de l’expérience
La loi prévoit la création d’un nouveau type de contrat de travail à durée indéterminée (CDI), à titre expérimental, le contrat de valorisation de l’expérience, qui pourra être conclu pendant une période de 5 ans après sa promulgation.
En fonction de la date à laquelle la loi sera publiée, l’expérimentation devrait démarrer fin septembre ou début octobre 2025, et se poursuivre jusqu’en septembre ou octobre 2030.
Une entreprise pourra recourir à ce contrat pour recruter une personne répondant à l’ensemble des conditions suivantes au moment de son embauche :
- Avoir au moins 60 ans (ou l’âge fixé par une convention ou un accord de branche étendu dans une fourchette allant de 57 à 60 ans) ;
- Être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de France Travail ;
- Ne pas pouvoir encore bénéficier d’une pension de retraite à taux plein de droit propre (sauf exceptions, régimes spéciaux des marins, de l’Opéra national de Paris et des mines, pension militaire) ;
- Ne pas avoir été employé par l’entreprise (ou dans une entreprise appartenant au même groupe) au cours des 6 mois précédents.
Le cas échéant, une convention ou un accord de branche étendu pourra préciser les missions devant être exercées dans le cadre de ce contrat.
Document que le salarié devra remettre à l’employeur à la signature du contrat
Lors de la signature du contrat de valorisation de l’expérience, le salarié devra remettre à l’employeur un document transmis par l’Assurance retraite mentionnant la date prévisionnelle à laquelle il remplira, le cas échéant, les conditions pour bénéficier d’une retraite à taux plein.
Si cette date est ultérieurement réévaluée, le salarié devra en informer son employeur et lui transmettre une version actualisée de ce document.
Le but est ici de donner à l’employeur une visibilité de la date à partir de laquelle il pourra, le cas échéant, le mettre à la retraite dans le cadre des dispositions spécifiques attachées au contrat de valorisation de l’expérience.
Les salariés sous contrat de valorisation de l’expérience pourront être mis à la retraite plus facilement
En France, les règles de mise à la retraite d’un salarié par l’employeur sont strictes :
- Il est impossible de mettre un salarié à la retraite avant 67 ans ;
- Entre 67 et 70 ans, l'employeur ne peut mettre à la retraite le salarié qu'avec son accord donné au terme d’une procédure d’interrogation chaque année ;
- Ce n'est qu'à partir de 70 ans que la mise à la retraite d'office, sans accord du salarié, est autorisée.
Considérant que cela peut décourager l’embauche de seniors, une règle dérogatoire a été prévue dans le cadre du contrat de valorisation de l’expérience.
L’employeur pourra mettre à la retraite un salarié qu’il emploie sous contrat de valorisation de l’expérience, sans avoir à recueillir son accord, à partir du moment où l’intéressé répond à l’une des conditions suivantes :
- Avoir atteint l’âge légal de départ à la retraite (compris entre 62 et 64 ans selon l’année de naissance) et disposer de la durée d’assurance requise pour obtenir une retraite à taux plein ;
- Ou avoir atteint l’âge légal d’attribution du taux plein automatique (67 ans à l’heure où nous rédigeons ces lignes).
L’employeur devra respecter un délai de préavis identique à celui prévu en cas de licenciement et verser au salarié une indemnité de mise à la retraite au moins égale à l’indemnité légale de licenciement.
Par ailleurs, l’employeur qui met un salarié à la retraite est en principe redevable d’une contribution patronale de 30 % due sur la fraction d'indemnité de mise à la retraite exonérée de cotisations de sécurité sociale (assujettie ou non à CSG/CRDS).
En cas de la mise à la retraite d'un salarié embauché sous contrat de valorisation de l’expérience, l’employeur sera exonéré de cette contribution patronale sur le montant de l’indemnité de mise à la retraite versée au salarié.


Gestion de paie
Optez pour une solution précise, efficace et fiable. Nous vous accompagnons avant, pendant et après l’installation. Avec Kelio, la paie est dans le mille !
Loi séniors : les nouveautés en paie
À la suite d’une commission mixte paritaire, le texte relatif à la « Loi Seniors » a été adopté par le Sénat.
Sauf retournement de situation imprévu, nous connaissons d’ores et déjà les futures dispositions légales qui seront adoptées par l’Assemblée nationale, puis publiées au Journal officiel à la rentrée.
Bonus-Malus : Exclusion de certains licenciements
Depuis septembre 2022, un mécanisme de bonus-malus sur la cotisation patronale d'assurance chômage s’applique aux employeurs de 11 salariés et plus de certains secteurs d'activité particulièrement concernés par le recours aux contrats courts.
Le taux de contribution modulé de l’entreprise soumise au bonus-malus dépend en effet de son « taux de séparation », déterminé au regard des fins de contrat de travail qui lui sont imputables.
Pour rappel, un avenant du 27 mai 2025 au protocole d’accord sur l’assurance chômage prévoit d’apporter plusieurs ajustements au dispositif du bonus-malus sur la cotisation patronale d’assurance chômage à compter du 1er mars 2026.
L’un de ces ajustements nécessite une mesure législative pour pouvoir être applicable.
C’est ce que permet le projet de loi qui prévoit d’exclure des paramètres de calcul du taux de contribution modulé de l’entreprise deux types de rupture du contrat de travail :
- Le licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle ;
- Le licenciement pour faute grave ou faute lourde.
À l’avenir, ces deux types de licenciement ne seront donc plus considérés comme des séparations imputées à l’entreprise.
Retraite progressive
Justification du refus employeur
Depuis le 1er septembre 2023, la loi encadre les demandes de temps partiel (ou de temps réduit pour un « forfait jours ») présentées par les salariés qui souhaitent bénéficier d’une retraite progressive.
L’employeur doit motiver un éventuel refus par écrit, le silence valant accord.
En effet, à défaut de réponse écrite et motivée dans les deux mois de la réception de la demande, l’employeur est réputé avoir donné son accord.
À ce jour, le refus de l'employeur doit être justifié par « l'incompatibilité de la durée de travail demandée par le salarié avec l'activité économique de l'entreprise ».
À l’avenir, la justification apportée par l'employeur à l’appui de cette incompatibilité devra rendre « notamment » compte des conséquences de la réduction de la durée de travail sollicitée sur la continuité de l’activité de l’entreprise ou du service, ainsi que, si ces conséquences impliquent un recrutement, des tensions pour y procéder sur le poste concerné.
Concrètement, l’employeur devra donc davantage motiver son refus.
Abaissement de l’âge de départ à la retraite progressive
Dans l’accord national interprofessionnel (ANI) du 14 novembre 2024 en faveur de l'emploi des salariés expérimentés (dit accord « Seniors »), les partenaires sociaux ont demandé aux pouvoirs publics de faire le nécessaire pour rendre la retraite progressive accessible dès 60 ans.
Cette mesure, qui ne nécessitait pas de disposition légale, a été transposée par un décret du 15 juillet 2025 dans la réglementation.
L'âge d’ouverture du droit à la retraite progressive est donc fixé à 60 ans pour les pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2025.
Il est utile de rappeler qu’indépendamment de l’âge, diverses autres conditions doivent être également remplies pour entrer en retraite progressive :
- Avoir 150 trimestres d’assurance et de périodes reconnues équivalentes tous régimes de retraite de base obligatoires confondus
- Exercer une activité à temps partiel ou à temps réduit, sous certaines conditions.
Financement du temps partiel de fin de carrière
À compter de la promulgation de la loi, un accord collectif d’entreprise ou d’établissement (ou, à défaut, un accord de branche) pourra prévoir, en cas de passage à temps partiel (ou à temps réduit pour un « forfait jours »), à la demande du salarié et en accord avec l’employeur, la possibilité d’affecter l’indemnité de départ à la retraite du salarié au maintien total ou partiel de sa rémunération.
En pratique, l'indemnité serait en tout ou partie fractionnée et versée de manière anticipée chaque mois pour compenser la perte de rémunération liée au passage à temps partiel (ou à temps réduit).
Au moment du départ en retraite, si le montant de l’indemnité due au salarié s’avère supérieur au montant des sommes déjà affectées au maintien de rémunération dans le cadre du passage à temps partiel (ou à temps réduit), l’employeur devra lui verser le reliquat.
Le salarié bénéficiant du versement anticipé de l’indemnité de départ à la retraite dans le cadre de ce dispositif ne pourra pas recourir à la retraite progressive.
Il est à noter que l’étude d’impact du projet de loi précise que la nature de l’indemnité de départ à la retraite n’étant pas modifiée, la mesure est sans incidence sur son régime social et fiscal.
Assouplissement de la procédure de mise à la retraite
A l’entrée en vigueur de la loi, les règles de mise à la retraite seront modifiées afin de préciser que ce mode de rupture des CDI pourra être mis en oeuvre y compris pour des salariés embauchés alors qu’ils ont déjà l’âge d’attribution automatique du taux plein, soit 67 ans à l’heure actuelle.
À l’avenir, les employeurs embauchant CDI des salariés de 67 ans et plus pourront ensuite les mettre à la retraite, puisque la loi le permettra expressément.
Pour ce faire, il faudra suivre les règles de droit commun en matière de mise à la retraite par l’employeur.
Par ailleurs, la loi apporte une précision sur la procédure d’interrogation du salarié que doit mettre en oeuvre l’employeur entre les 67 ans et 70 ans d’un salarié, s’il souhaite le mettre à la retraite.
La précision en question concerne les conditions dans lesquelles l’employeur interroge par écrit le salarié sur son intention de quitter volontairement l’entreprise.
Outre le cas où l’interrogation concernerait un salarié pouvant quitter ses fonctions « pour bénéficier d’une pension de retraite », l’interrogation du salarié pourra également porter sur son intention de quitter volontairement l'entreprise pour bénéficier « continuer à bénéficier » d'une pension de vieillesse.
Individualisation du taux PAS
Jusqu’au 31 août 2025, le taux de PAS des conjoints ou partenaires pacsés soumis à imposition commune est en principe calculé en tenant compte de l’ensemble des revenus et charges des intéressés, et appliqué pareillement à chacun des membres du couple, sans tenir compte de leurs revenus propres.
Les personnes concernées peuvent néanmoins demander à l’administration fiscale l’application d’un taux individualisé en fonction du niveau des revenus de chacun des membres du couple.
Le choix de taux individualisés est neutre sur l’impôt final dû, puisque le montant total sera strictement identique.
Le seul impact tient à la répartition différente de l’impôt entre conjoints.
À partir du 1er septembre 2025, le taux de PAS individualisé s’appliquera automatiquement aux couples mariés ou pacsés, sauf pour les contribuables concernés ayant opté auprès de l’administration fiscale pour le taux global du foyer fiscal.
Dans une actualité du 29 juillet 2025, le GIP-MDS indique que, pour le déclarant DSN, la mécanique établie depuis le démarrage du prélèvement à la source n’est en rien impactée par cette réforme : le déclarant continuera de recevoir de la DGFiP les taux de PAS dans un compte rendu métier (CRM) nominatif, et pourra donc l’appliquer dans les DSN suivantes selon les mêmes consignes qu’auparavant.
Sans changement, le déclarant DSN n’aura pas connaissance de l’option exercée par le salarié
C’est bientôt la rentrée, et si vous faisiez le point sur vos outils de paie ? Découvrez comment vous simplifier la vie avec la solution complète 123Paie.